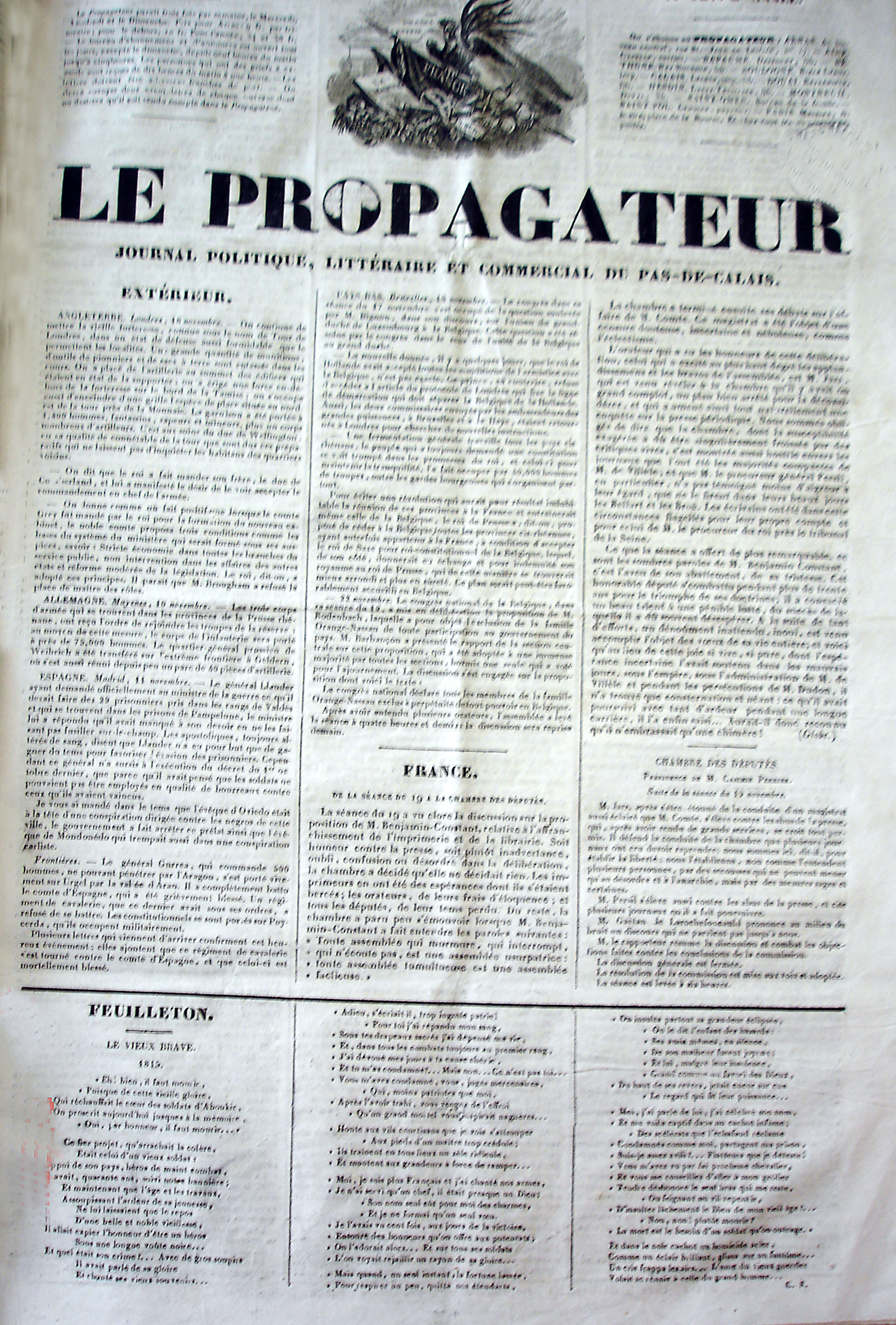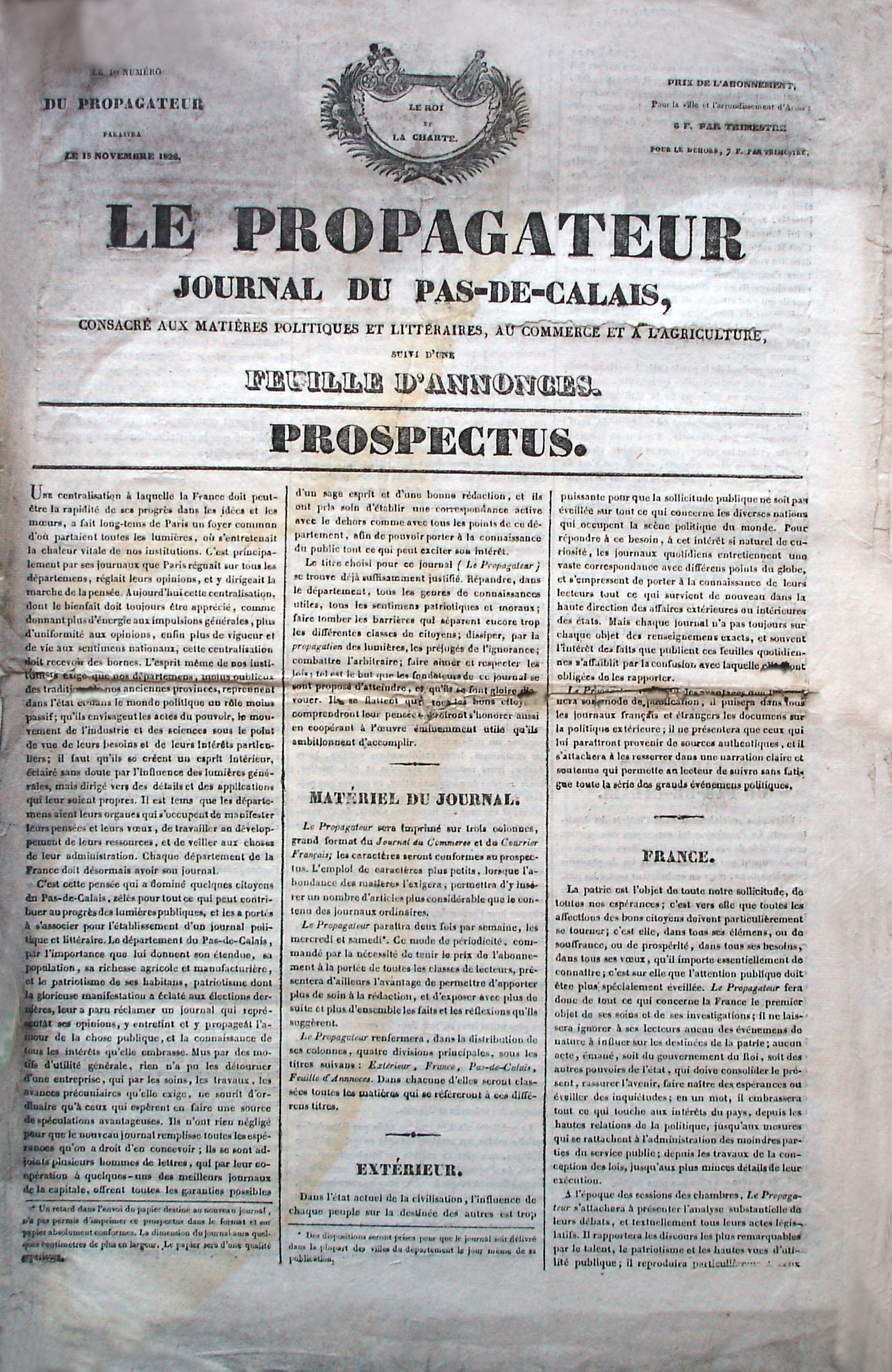PROPAGATEUR (LE)
Le Propagateur. Journal du Pas-de-Calais
Quelques semaines après la visite triomphale de Charles X dans le Pas-de-Calais, l'opposition est le grand vainqueur des élections de novembre 1827. Cette nouvelle donne entraîne en janvier 1828 la démission du ministère Villèle. Son successeur Martignac est contraint à quelques concessions. Ainsi la loi du 18 juillet sur la presse périodique supprime l'autorisation préalable et la censure, diminue le cautionnement.
C'est dans ce contexte qu'Arras se voit doter, pour la première fois depuis la disparition du Journal du département du Pas-de-Calais en 1819, d'un journal politique. Le 15 novembre 1828, des presses de Gustave Souquet qui vient d'abandonner la Revue départementale (Cf. notice) quelques jours plus tôt, sort Le Propagateur. Journal du Pas-de-Calais consacré aux matières politiques et littéraires, au commerce et à l'agriculture, suivi d'une feuille d'annonces
Cet hebdomadaire a été fondé le 24 septembre par deux riches propriétaires arrageois François Hippolyte Corne de Brillemont et Charles Louis Marie Eugène Harlé, un homme de Lettres, Frédéric Degeorge, demeurant à Béthune, et un avocat à la cour royale de Paris, Charles Ledru. Le fonds social de la société se compose de deux cents actions de cent francs chacune. Le cautionnement de 12 000 F a été fourni à parts égales par les quatre fondateurs. Le gérant responsable en est Frédéric Degeorge dont les appointements ont été fixés à 2 400 F (1).
Cette nomination, à l'initiative de Charles Ledru, semble avoir soulevé quelques réticences de la part de Harlé que Corne de Brillemont dut convaincre. Fils d'un adjudant-major de l'armée de Hoche et d'une Béthunoise, Frédéric Degeorge est né le 12 septembre 1797 en Wesphalie. Engagé à 16 ans dans le même régiment que son père, il participe notamment à la bataille de Waterloo. Après un retour à Béthune, il commence, en 1819, des études de droit à Paris. Un an plus tard, il est exclu de la faculté pour avoir manifesté avec les étudiants libéraux contre la loi électorale du double vote (2). En 1828, il vient tout juste de rentrer d'exil de Londres où il a passé cinq ans après avoir été condamné à mort par contumace, le 24 mars 1824, par la Cour d'assises de Saint-Omer. Membre de la Charbonnerie (3), il avait en effet été impliqué, en 1823, dans une conspiration visant à soulever les soldats de l'expédition d'Espagne contre le régime. À Londres, d'abord maître de langues dans plusieurs écoles, il a collaboré à plusieurs revues politiques et littéraires anglaises et espagnoles, il a même été correspondant de deux journaux français Globe et La Revue encyclopédique. L'exil lui pesant, il rentre en France. Il se constitue prisonnier et est acquitté par la cour de Saint-Omer. « M. Harlé […], écrira en 1842 Degeorge, craignait qu'un proscrit politique rentrant dans sa patrie, après cinq ans d'exil, ne donnât une couleur trop tranchée au journal nouveau (4). »
LE ROI ET LA CHARTE
L'objectif du journal, dont la devise est « Le roi et la charte », semble à la fois ambitieux et modéré si l'on en croit le prospectus diffusé avant sa parution : « Le titre choisi par ce journal (Le Propagateur) se trouve déjà suffisamment justifié. Répandre, dans le département, tous les genres de connaissances utiles, tous les sentiments patriotiques et moraux ; faire tomber les barrières qui séparent encore trop les différentes classes de citoyens ; dissiper par la propagation des lumières, les préjugés de l'ignorance, combattre l'arbitraire, faire aimer et respecter les lois, tel est le but que les fondateurs de ce journal se sont proposés d'atteindre et qu'ils se font gloire d'avouer. Ils se flattent que tous les bons citoyens comprendront leur pensée et croiront s'honorer aussi en coopérant à l'œuvre éminemment utile qu'ils ambitionnent d'accomplir. »
Cependant, certains détails sont déjà révélateurs des intentions des fondateurs du journal : combattre les ultras. Pour mieux affirmer leur fidélité à la monarchie constitutionnelle, le prospectus reproduit le texte de la Charte. Octroyée par Louis XVIII, mais mal acceptée par son successeur et frère Charles X et les ultras qui l'entourent, cette charte est devenue le cri de ralliement des libéraux.
« Imprimé sur trois colonnes, grand format du Journal du Commerce et du Courrier français », Le Propagateur paraît deux fois par semaine, les mercredi et samedi. « Ce mode de périodicité, explique toujours le prospectus, a été choisi pour tenir le prix de l'abonnement à la portée de toutes les classes de lecteurs. » Il est fixé pour Arras et son l'arrondissement à 6 F par trimestre et pour le dehors à 7 F. Les fondateurs du Propagateur visent d'ailleurs un large lectorat puisque les abonnements peuvent être souscrits au bureau du journal, 248, rue du Cornet à Arras, mais aussi à Béthune, chez Desavary ; à Boulogne, chez Le Roy-Berger et chez J. Le Roy ; à Calais chez Le Roy ; à Montreuil, chez Duval ; à Saint-Omer, chez Chanvin dit Gougeon, et même dans le département du Nord à Cambrai, chez l'imprimeur Berthould ; à Douai, chez le libraire Tarlier, et chez l'imprimeur Wagrez ; à Lille, chez Leleux, éditeur de l’Écho du Nord.
Présenté sur trois colonnes, Le Propagateur comprend quatre grandes sections intitulées respectivement : Extérieur, France, Pas-de-Calais, Feuille d'Annonces, mais aussi un feuilleton. Les articles sont signés FD, JS, LM, LD.
L'irruption du Propagateur dans le paysage paisible de la presse arrageois ne plaît guère aux Affiches, annonces. « Notre journal […] avant même la publication de son premier numéro, avait déjà été en butte aux sarcasmes d'une feuille qui s'imprime dans le chef-lieu de département (5) », écrira plus tard Frédéric Degeorge. Dès le cinquième numéro, il se targue d'un certain nombre de patronages : celui du baron de Hauteclocque, maire d'Arras, et des maires de Saint-Pol, d'Hesdin et des autres principales villes et communes du département, de l'encouragement de la majorité des députés du département et d'un accueil chaleureux de la part des habitants. « On a vu que franchement attachés à cette charte constitutionnelle que nous ont donnée les Bourbons, nous n'avions pour objet ni de prêcher l'anarchie, ni d'exciter à la révolte, proclame le rédacteur en chef. On a pu se convaincre qu'amis sincères de la tolérance, nous saurions unir la défense de la liberté des consciences au respect que nous avions de la religion de l'État. On a pu reconnaître que nous tiendrions les promesses faites dans notre prospectus, que Le Propagateur ne serait point un journal de coterie, que sa mission était de défendre les libertés publiques, de propager tout ce qui est bon et grand, utile, d'attaquer les abus, mais de respecter la vie privée des citoyens et de ne point se faire l'écho du scandale. »
HARO SUR LES ULTRAS
Même si cette affirmation suscite un démenti du maire d'Arras et la première polémique au centre de laquelle se retrouve le journal, le ton reste modéré. L'arrivée de l'un des chefs des ultras à la tête du ministère, Polignac, le 8 août 1829 change la donne. Le 12, Le Propagateur traduit l'état d'esprit de tous les libéraux : « Nous ne pouvons rien attendre de bien, de bon, de favorable à la prospérité de la France du ministère qui nous est donné. »
Le 15, sous la rubrique France, il présente « les nouveaux ministres ». Il s'en prend violemment au comte de Bourmont, « ce transfuge de la Vendée, ce déserteur de Waterloo [placé] à la tête de notre brave armée ». Il « a fait, explique Degeorge, son apprentissage dans le métier des armes, en combattant contre la France ». Et d'en retracer le parcours politique ondoyant : « Royaliste, tant que la République menaça ruine, le comte de Bourmont abandonna le drapeau blanc pour la cocarde tricolore, du premier instant que la cause de la monarchie lui sembla perdue. Confident et obligé du comte d'Artois, il abandonna ce prince et l'exil, et vint plier les genoux devant les prospérités du Premier consul. Courtisan adroit, il en obtint des faveurs et des places et pour payer les bienfaits qu'il en avait reçus, il fut soupçonné une première fois, d'avoir voulu attenter à la vie de son protecteur, et convaincu, quinze ans plus tard, d'avoir trahi ce maître trop confiant qui lui avait pardonné, et, par cette trahison, avoir entraîné sa ruine, et changé en cyprès les lauriers de Waterloo !… » Comme si ce tableau ne suffisait pas, Degeorge insiste sur la trahison du général Bourmont dans son feuilleton intitulé « Le soir de la bataille de Waterloo ». Il récidive le 28 octobre 1829 avec un poème de Mery et Barthélemy « Waterloo » dédié au même général.
Dans les jours qui ont suivi la nomination du ministère, Degeorge s'en prend également au ministre de l'Intérieur La Bourdonnaye, « émigré de Coblentz, soldat de Condé, vendéen et chouan, républicain sous le consulat, impérialiste sous l'empire, contre-révolutionnaire depuis la restauration », à Polignac lui-même.
Le Propagateur n'a désormais de cesse que de dénoncer la politique du ministère. Ce qui lui vaut la vindicte du régime. En novembre, Souquet qui veut transmettre son affaire voit son successeur refusé par La Bourdonnaye, sans motif. Le Propagateur crie à une « nouvelle attaque contre le presse » : « M. Audibert, succédant à M. Souquet, devenait l'imprimeur du Propagateur, cela déplaît aux hommes qui voudraient museler les journaux ; pour leur plaire, il eut fallu que M. Souquet présentât un successeur qui refusant de prêter ses presses à notre feuille eut nécessairement amené sa ruine.
Mais il ne tombera pas le journal du Pas-de-Calais, le département a encore besoin de son aide, il l'aura. On le frappe, on contrarie des intérêts privés, mais l'intérêt général sortira sans blessure du coup qu'on veut lui porter. Que M. Souquet reste imprimeur ou qu'il fasse accepter pour son successeur un protégé de la congrégation, lui ou cet homme nous prêteront leurs presses, car Le Propagateur a un acte qui leur impose cette obligation. »
Le journal de Degeorge n'en poursuit pas moins son combat. Il se fait le propagandiste des associations pour le refus de l'impôt qui se créent en France. Comme l'Annotateur boulonnais, le 5 décembre 1829, il annonce la création d'une association dans le Pas-de-Calais. Lorsque Birlé, éditeur du journal boulonnais, et Verjux, rédacteur, sont poursuivis par la justice, il prend leur défense.
En mars 1830, après l'adresse des 221 (6), le roi dissout la Chambre. Lors des élections de juin et juillet, Le Propagateur qui met l'accent sur l'action néfaste des ultras redit son attachement à la charte. Il apporte donc son soutien aux candidats constitutionnels : Harlé père à Arras, Degouve-Denuncques à Hesdin, Harlé fils à Saint-Omer, Fontaine à Boulogne qui remportent les quatre sièges aux collèges d'arrondissement, Gerbé et Lesergeant de Bayenghem qui enlèvent deux des trois sièges au grand collège.
Les événements se précipitent à Paris. En application des quatre ordonnances signées par le roi, le 27 juillet, le préfet du Pas-de-Calais retire au Propagateur son autorisation de paraître. Degeorge passe outre. Il lance un appel aux Arrageois : « Le roi est trompé ; éclairons le roi, adressons-nous à sa sagesse ; révoquons sa justice ; que tous les corps de l’État, que tous les bons citoyens fassent attendre leurs voix ; qu'ils repoussent l'arbitraire ; qu'ils se cuirassent contre l'illégalité ; qu'ils se rappellent toute leur énergie, que des pétitions arrivent de toutes parts aux pieds du trône ; la situation est grave ; il y va de la tranquillité de la France, du salut de la monarchie, de la conservation de nos libertés ; c'est dans les grands périls que se montrent les grands courages ; les Français ne dégénéreront pas de leur ancienne réputation et les fils aînés de la Liberté ne consentiront pas à descendre au rang des plus vils esclaves. » La réponse du préfet est immédiate, le 28 au matin, les presses de l'imprimeur du journal sont scellées puis saisies.
Le journal ne reparaît que le 4 août. Le numéro porte les dates « du vendredi 30 juillet au mercredi 4 août ». Les mots « Paix ! Liberté ! » remplacent la devise « Le Roi et la Charte ». Dans la rubrique arrageoise, la rédaction informe ses lecteurs des conséquences de son refus des ordonnances : « Les scellés placés sur nos presses, l'enlèvement postérieur de tous les caractères de notre imprimerie nous ont empêché de paraître jusqu'à ce jour. Nous ne pouvons donner à nos abonnés qu'une demi-feuille du Propagateur, la moitié de l'imprimerie étant à la mairie dans un tel désordre qu'il est impossible de s'en servir. Sur les quatre presses saisies, deux ont été cassées dans le déménagement, la nature de cet accident les met hors d'état de servir. » Cependant, malgré les obstacles, la rédaction n'en a pas moins poursuivi sa mission d'informateur comme elle le rappelle le 20 août : « Le Propagateur n'avait pas moins continué à paraître : une presse et quelques casses de caractères, qu'on était parvenu à soustraire aux perquisitions de l'autorité, fournirent pendant toute la durée de la crise à l'impression du journal condamné. »
UN PROSCRIT DEVENU RECOMMANDABLE…
Frédéric Degeorge qui avait gagné Paris pour y suivre les événements, ne reprend sa place au journal que le vendredi 13 août. L'arrivée du nouveau régime marque un net changement pour Le Propagateur. Blin de Bourdon, ex-préfet du Pas-de-Calais, de La Rivière, ex-secrétaire général, et de Hauteclocque, ex-maire d'Arras, qui avaient ordonné la saisie et l'enlèvement illégal de ses presses sont condamnés à payer une somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts à Souquet. Le nouveau préfet lui accorde même le titre d'imprimeur de la préfecture.
En octobre, le préfet s'adresse aux maires du département pour leur recommander Le Propagateur qui « professe des principes si conformes aux opinions de la majorité des habitants du Pas-de-Calais » : « Les services que ce journal a rendus à la cause nationale et ceux qu'il peut lui rendre encore, écrit-il, me portent à vous le recommander. » Degeorge reconnaît de son côté que « le gouvernement leur [aux journaux] accorde protection parce que son chef est l'ami de la publicité et que la publicité, dangereuse à la tyrannie, est utile à la liberté. […] Le Propagateur proscrit, il y a deux mois, peut maintenant circuler dans nos communes, de la mairie au presbytère, avec l'agrément de l'autorité. » Du 17 novembre 1830 au 31 décembre 1830, la gérance du journal est confiée à Jean Degeorge, frère du rédacteur en chef. Membre de la société “Aide-toi, le Ciel t'aidera”, Frédéric Degeorge est à Paris où en décembre, en compagnie de Baude, Cauchois-Lemaire, Chevallier, Dupont et Garnier-Pagès, il présente au roi un mémoire sur l’état de Paris pendant les journées des 19, 20 et 21 et leurs causes.
Le 24 novembre, drapeau tricolore et coq gaulois au-dessus du titre, le journal change de têtière. L'euphorie est de courte durée. Un des fondateurs du journal, Harlé fils, a préféré s'éloigner et probablement participer à la transformation du Courrier du Pas-de-Calais en feuille politique. Le Propagateur glisse vers une opposition au régime. Quelques exemples au fil des différents numéros. En 1833, au plus fort de la lutte pour la liberté de la presse, « Nous voilà revenus à la liberté du Figaro. Pourvu que je ne parle ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l'opéra, ni des autres spectacles, ni des personnes qui tiennent à quelque chose, je puis tout imprimer. » En janvier 1835, Degeorge ouvre ses colonnes à Louis Blanc, précepteur chez l'industriel Alexis Hallette. Il y démontre la supériorité de la république sur la monarchie.
En août, il condamne l'attentat contre le roi : « Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que la fin justifie les moyens ; et nous ne voudrions pas d'une victoire qui serait achetée par l'assassinat. ». Cependant, il refuse l'accusation portée contre la presse républicaine. Au contraire, il en fait porter la responsabilité au ministère : « C'est le loyal et généreux Carrel ; c'est Raspail (7), dont l'aversion du meurtre se montre dans chaque ligne qu'il écrit ; ce sont les rédacteurs en chef du National, du Réformateur, du Charivari, du Corsaire qu'on jette en prison ; c'est la presse républicaine qu'un journal ministériel accuse d'avoir poussé à l'assassinat Jacques Gérard, quand il paraît jusqu'ici prouvé que ce n'est pas du fanatisme républicain que ce meurtrier était imprégné.
Il faut s'attendre à ces accusations contre la presse patriote, la presse patriote gêne le pouvoir dans son retour à l'ancien despotisme, la presse patriote est une concurrence embarrassante pour les feuilles stipendiées.
À ce déchaînement contre les journaux de l'opposition, à cet appel des persécutions, fait contre la presse, à cette accusation stupide que c'est la presse qui est la cause de tout le mal qui se peut faire, de tout le mal qui se fait, nous répondrons : y avait-il donc une presse lorsque Mallet [sic] (8) ébranla si fortement à lui seul le trône impérial ?…
Ce n'est pas la presse, ce sont les mauvais gouvernants qui suscitent, qui amènent toutes les perturbations, tous les grands attentats qui désolent et épouvantent le monde. Administrez paternellement, libéralement, justement et un état sera à l'abri des émeutes et des révolutions ; et nous n'aurons pas à détester et à flétrir d'odieux assassinats. »
AUTANT D'ASSIGNATIONS QUE D'ACQUITTEMENTS
Journal d'opposition sous le ministère Polignac, puis, sous la monarchie de Juillet, après la chute du ministère Laffitte (9), Le Propagateur est butte à de nombreuses poursuites. Celles-ci commencent dès juin 1828. À la suite d'un article relatant le naufrage d'un bateau anglais près du Portel ayant entraîné la mort du seul rescapé, le journal met en doute la conduite des agents des douanes. Ce premier procès se solde par l'acquittement du gérant. Il n'est que le prélude à une longue série qu'il serait fastidieux d'énumérer.
Le 19 août 1835, à l'occasion d'une nouvelle assignation à comparaître devant les assises, Le Propagateur évoque « trente à quarante saisies » de la part des gens du roi. Lors de son nouvel acquittement, en septembre, il écrit : « Traduit pour la 11e fois devant le jury depuis la révolution de Juillet, nous venons d'obtenir notre 11e triomphe. On voulait que nous allassions expier au Mont-Saint-Michel le cri d'indignation que nous avait arraché les lois Fieschi ; mais nos concitoyens ont refusé au parquet cette satisfaction. » Quelques jours plus tard, il dresse un bilan : « Les hommes du pouvoir profiteront-ils de la nouvelle leçon que le jury vient de leur donner ?
En moins de quatre ans, plus de vingt articles du Propagateur ont été poursuivis par les gens du parquet, dont pas un seul n'a été condamné. Envoyé onze fois devant la cour d'assises, onze fois le verdict du jury a prononcé notre acquittement. 132 citoyens, choisis sur les 3 000 plus riches, plus éclairés, plus notables du département ; 132 jurés ont été appelés depuis quatre ans, à se prononcer entre les procureurs du roi et Le Propagateur et sur 132 citoyens, 124 ont été unanimes pour nous déclarer non coupables, pour repousser, comme injustes, les poursuites de nos adversaires ; pour décider que, dans notre mission de journaliste nous n'avions ni failli à l'honneur, ni trahi à la vérité, ni manqué au pays. »
Le journal peut triompher, le pouvoir ne s'avoue pas vaincu et sa réponse ne tarde pas. La loi sur la presse promulguée le 9 septembre 1835 (10) lui donne de nouvelles armes et, dans son édition du 26 septembre, Le Propagateur annonce, comme s'il lui décernait un titre de gloire, « à M. de Champlouis l'honneur d'avoir le premier, des préfets de département, exercé les nobles fonctions de censeur. »
Et de s'expliquer auprès de ses lecteurs : « On sait que conformément à l'article 20 de la loi du 9 septembre dernier "aucun dessin, aucunes gravures, lithographies, médailles et estampes, aucun emblème de quelque nature et espèce qu'ils soient, ne peuvent être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de l'Intérieur, à Paris, et des préfets dans les départements."
Ainsi le coq gaulois, placé depuis 1830 au frontispice du Propagateur, devait passer par la censure. Injurieux affront que nous voulûmes lui éviter en présentant à sa place la liberté de la presse, telle que l'ont faite les doctrinaires. Mais cette liberté, toute bâillonnée toute enchaînée qu'elle était fit néanmoins encore peur à M. de Champlouis, et défense lui fut enjointe de se montrer.
Apparaissant sous les traits d'une jeune et belle femme, nous ne pensions pas que notre liberté de la presse recevrait un si incivil accueil de la part du préfet ; chargée de chaînes et tenue dans un cachot, elle devait, si ce n'est de la sympathie, inspirer au moins quelque compassion.
Elle ne s'était pas, comme nous, fait illusion, l'infortunée, elle savait, elle, combien est dure l'âme d'un censeur. Aussi, en se présentant à lui avait-elle pris des vêtements de deuil, ses longs cheveux tombaient en désordre sur ses épaules et sur son sein, la pâleur était sur son front, et son regard abattu était dirigé vers le ciel.
Le censeur chassa la liberté et se réjouit de cet exploit d'esclave. Il a exercé un acte de vengeance que ses maîtres lui avaient commandé, et on dirait, à ses ris, à la satisfaction qu'il éprouve lui-même, qu'il a rempli un acte de justice, qu'il a sauvé, d'une affreuse catastrophe, la société. »
Le préfet s'acharne. En octobre, il traduit le journal en justice pour refus d'insertion d'une lettre. Le 15 novembre Le Propagateur informe ses lecteurs : « L'administration est plus heureuse devant les juges civils que devant les jurés, et elle obtient des tribunaux correctionnels du Pas-de-Calais des condamnations contre Le Propagateur, que lui refuse constamment le jury. Nous avons perdu hier notre procès à Saint-Omer. Le Tribunal, après en avoir délibéré douze minutes, est rentré en séance, adoptant purement et simplement les motifs du jugement par défaut qui avait été rendu contre nous. » Le journal fait appel, mais ses lecteurs ne liront pas le compte rendu dans ses colonnes.
LES ACTIONNAIRES SE REBIFFENT…
Le Propagateur est pourtant une réussite. Lors de la première assemblée générale de ses actionnaires, le 27 août 1829, l'action a rapporté un dividende de 6,5 % par an. « Les fondateurs et actionnaires, rapporte le journal, ont été unanimement d'avis que ce premier dividende ne serait point immédiatement soldé aux porteurs d'actions, mais qu'il serait ajouté à l'avoir du journal, pour venir en augmentation du dividende qu'on pourra avoir à leur payer lors de la seconde réunion en août 1830. […] À peine arrivé à son septième mois d'existence, [Le Propagateur] a offert un exemple peu commun dans la presse périodique, celui de donner un dividende de 6, 5 % à ses actionnaires, dividende qui se serait élevé à 15 % si les dépenses des six premières semaines de 1828 n'avaient excédé les recettes et si un procès gagné en première instance et en appel et néanmoins onéreux au journal, n'était venu frapper celui-ci aux premiers temps de sa naissance… »
Quelques mois plus tard, le 7 avril 1830, les propriétaires augmentent même sa périodicité, trois fois par semaine au lieu de deux, moyennant une augmentation du prix de l'abonnement : à Arras, 34 F pour une année, 17 F pour six mois, 9 F pour trois mois.
En 1830 et en 1831, un dividende est versé aux actionnaires. Le journal continue à se transformer, en janvier 1832 où il paraît tous les deux jours. Les années suivantes, les résultats ne semblent plus à la hauteur de ces premiers résultats. Lorsque la société du Propagateur est dissoute le 1er janvier 1836, le déficit est de 2 399, 42 F (11). Cependant la raison de la disparition est ailleurs selon son rédacteur en chef.
En septembre 1835, la nouvelle loi sur la presse a porté le cautionnement à 15 000 F pour les quotidiens publiés dans une ville de moins de 50 000 habitants. Les journaux ont quatre mois pour se mettre en conformité avec la loi. Créé pour assurer la victoire des constitutionnels, sous l'impulsion de Degeorge, Le Propagateur est devenu un organe républicain. Cette orientation est loin d'être partagée par tous les actionnaires du journal. Ceux-ci ne consentent, expliquera Degeorge en 1850, à « faire le supplément de cautionnement exigé par l’État qu'à la condition que le journal modifierait sa politique et deviendrait aussi tiède qu'eux. (12) » Condition refusée par les rédacteurs (13).
En décembre, les ennuis continuent d'ailleurs pour la société. À l'occasion de la sortie de L'Almanach populaire du Pas-de-Calais qu'elle publie depuis 1834, la police envahit les locaux de l'imprimerie et de la rédaction. La revue s'en prend au roi avec « un dessin représentant un rifflard (sic) surmonté d'un chapeau encocardé » et « un article assez drolatique, intitulé Physiologie du Rifflard » (14) enfin dans un dialogue entre un Américain et un Français, elle disserte sur l'excellence des gouvernements populaires. Dans son édition du 5 décembre, Le Propagateur s'amuse de l'échec de la police : « Deux commissaires de police et une demi-douzaine d'agents, venaient faire main basse sur le malencontreux almanach.
La capture n'a pas été grande. 2 200 exemplaires du petit livre avaient été vendus à Arras en deux jours. On n'en a plus trouvé un seul chez les libraires. Il a fallu se contenter d'emporter ceux en feuilles que le brocheur achevait d'assembler. » Pourtant, après une deuxième descente de police quelques jours plus tard, des poursuites sont une nouvelle fois engagées. Depuis les actionnaires avaient nommé trois liquidateurs Arnoust, Monvoisin et Wattringue. Chacun d'entre eux aurait à avancer la somme de 13, 70 F par action qu'il détenait pour éponger le déficit.
(1) Le Progrès du Pas-de-Calais, vendredi 6 mai 1842, XIVe année, n° 62.
(2) Cette loi dont l'objectif était de réduire l'opposition à la Chambre permettait aux électeurs les plus riches de voter deux fois. Sur les 430 députés que comptait la Chambre, les contribuables payant 300 F d'impôt en élisaient 258, puis les plus riches d'entre eux en nommaient encore 172.
(3) Association secrète regroupant environ 35 000 membres : militaires en activité ou en demi-solde, étudiants,… dont l'objectif est de chasser les Bourbons et de rétablir le drapeau tricolore.
(4) Ibidem.
(5) Cf. Notice sur la Revue départementale.
(6) Après le discours du Trône du roi pour l'ouverture de la session parlementaire, 221 députés votent une adresse appelant le gouvernement à respecter les principes de la Charte. Cette adresse apparaît comme un manifeste de l'opposition libérale. Charles X répond par la dissolution de la Chambre le 16 mai.
(7) Fondateur du National avec Thiers, Armand Carrel est un des chefs de l'opposition républicaine. François Raspail est le chef de la Société des amis du Peuple et le fondateur du journal Le Réformateur.
(8) Le général Claude François de Malet fomenta une conspiration contre Napoléon en octobre 1812. Arrêté, il est fusillé.
(9) Chef de l'opposition libérale sous la Restauration, Laffitte est nommé président du Conseil le 3 novembre 1830. Il démissionne le 3 mars 1831.
(10) Après l’attentat manqué de Fieschi, le 28 juillet 1835, contre Louis-Philippe, trois lois d’exception sont votées dans le courant du mois d’août et promulguées en septembre. La loi du 29 août sur la presse interdit de discuter la personne du roi, la charte et la forme du gouvernement. Le montant du cautionnement est augmenté. La publication des gravures, des dessins est soumise à autorisation.
(11) Le Progrès du Pas-de-Calais, 21 mai 1850.
(12) Ibidem.
(13) Dans une lettre reproduite le 21 mai 1850 par Le Progrès, Lantoine-Harduin accuse Degeorge d'être responsable de la disparition du Propagateur : « Je sais que ce journal dirigé par vous est mort d'inanition en 1835 ; que ses actionnaires y perdirent, non seulement le montant de leurs mises mais furent en outre déclarés débiteurs de 13 fr par action. Je sais encore qu'au Propagateur, propriété sociale, déclaré mort par vous, a succédé inopinément et sans solution de continuité, le Progrès, votre propriété personnelle ; je sais aussi que si vous avez fait de mauvaises affaires, quand vous étiez à la tête du Propagateur vous en avez faites de très bonnes lorsque vous gériez pour votre propre et unique compte, attendu qu'après avoir vu mourir Le Propagateur dans vos mains, vous avez déclaré en 1847 que le journal qui lui succédait vous rapportait annuellement treize mille francs de bénéfices nets.
Actionnaire du Propagateur, j'ai tout perdu comme les autres actionnaires. Si comme vous l'avez affirmé j'avais eu des actions au Progrès j'aurais gagné. »
(14) Le riflard désigne un parapluie, objet dont est souvent affublé, dans les dessins satiriques, Louis-Philippe, le roi bourgeois.